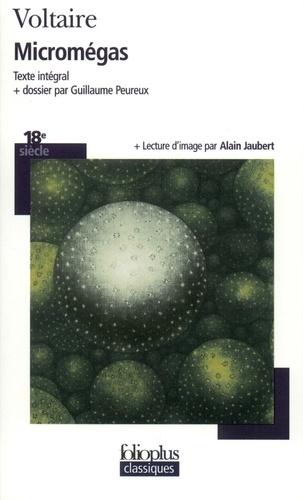GF-Flammarion n°117, 1966, pages 98-99.

Libellés
- Méditations (21)
- Littérature (14)
- Philosophie (13)
- XVIIIe siècle (8)
- Anarchisme (7)
- Art (6)
- Divers (6)
- Document (5)
- Texte du mois. (5)
- Spectacle (4)
- Citation(s) (3)
- Coup de gueule (3)
- Histoire (3)
- Pensée alternative (3)
- XIXème siècle. (3)
- Abstentionnisme (2)
- Compte-rendu (2)
- Conte philosophique (2)
- Roman (2)
- Voltaire (2)
- humour (2)
- Deuxième Sexe (1)
- Féminisme (1)
- Individualisme (1)
- Manga (1)
- Notes de cours (1)
- Poésie. (1)
- Présentation (1)
- Télévision (1)
- surréalisme (1)
Le mot de la semaine
Diderot, Lettre à Landois, 29 juin 1756
. ............................................................................................................ .
Autonomie, liberté et aliénation sociale.
GF-Flammarion n°117, 1966, pages 98-99.
Posted by : Glyndŵr on vendredi 5 juin 2009 | Libellés : Citation(s), Document, Littérature, Méditations, Philosophie, XVIIIe siècle | 1 Comments
I. Caractère de Diderot (par G. Lanson).
« La tête d’un Langrois est sur ses épaules comme un coq au haut d’un clocher : elle n’est jamais fixe dans un point ; et si elle revient à celui qu’elle a quitté, ce n’est pas pour s’y arrêter. Avec une rapidité surprenante dans les mouvements, dans les désirs, dans les projets, dans les fantaisies, dans les idées, ils ont le parler lent. Pour moi, je suis de mon pays ; seulement le séjour de la capitale et l’application assidue m’ont un peu corrigé. » Denis Diderot, Langrois devenu Parisien, s’était corrigé en effet, mais non pas de la façon qu’il croyait. Son esprit avait gardé la promptitude à virer : mais il avait égalé l’impétuosité de son élocution à la rapidité de sa pensée. Il est bavard, conteur, conseilleur, raisonneur. Ce fils d’un petit coutelier de Langres n’a jamais été du monde : il a étalé dans les salons que sa renommée lui ouvrait, des façons débraillées, vulgaires ; mais de toutes les convenances mondaines, s’il y en a une qu’il a bien foulée aux pieds, c’est celle qui bride la langue. Gros mangeur, gourmand, il ne nous fait pas grâce de ses indigestions : il est plein de son sujet, il faut qu’il parle. Il a la gaité du peuple, énorme, ordurière ; où qu’il soit, devant n’importe qui, il fait qu’il lâche les sottises qui bouillonnent dans sa tête : il faut qu’il parle. Il a la franchise du peuple, celle de l’Auvergnat de Labiche plutôt que de l’Alceste de Molière : il jette au nez des gens leurs vérités ; il les pense, elles jaillissent : il faut qu’il parle. Il a des amis, qu’il voit agir, faire des projets, arranger leur vie : il se jette à travers leur existence, à travers leurs plus intimes sentiments, conseillant, disposant, indiscret, impérieux ; c’est la corneille qui abat des noix ; et voilà comment il se brouille avec Rousseau : il veut le retenir à Paris, l’envoyer à Genève ; il décide, il dirige ; il faut qu’il parle.
Bonhomme au reste, obligeant, généreux, tout plein de bons sentiments, bon fils, bon frère, bon père, bon mari même, à la fidélité près, bon ami, chaud de cœur, enthousiaste, toujours prêt à se donner et se dévouer : à condition seulement qu’il puisse s’épancher librement, toujours heureux de se mettre en avant, d’être d’une négociation, d’une affaire où il y ait à brûler de l’activité, à évaporer de la pensée en paroles. C’est le moins égoïste, le plus désintéressé des hommes, pourvu qu’il se dépense. Il a traversé son siècle, constamment dans la fièvre, emballé, débordant, jamais las, grisé de l’incessante fermentation de son cerveau ; et plus il disait, plus il avait à dire.
Sa robuste organisation fournissait à toutes les dépenses. C’était un étourdissant causeur ; sa conversation était un feu d’artifice, où l’on voyait passer avec une vertigineuse rapidité images, idées, polissonneries, sciences, contes, métaphysique, rêves fous, hypothèses fécondes, divinations étonnantes. Au coin du feu dans son logis de la rue Taranne, au café de la Régence, à la Chevrette cher Mme d’Epinay, au Grandval chez le baron d’Holbach, Diderot était toujours prêt, toujours chauffant, partant sur un mot, sur un signe. Et quand il avait bien conté, disputé, crié, il lui restait du surplus qui ne s’était pas donné passage : il prenait la plume, et continuait la conversation tantôt avec le même interlocuteur, tantôt avec un autre ; il écrivait à Falconet ou à Mlle Volland. Et ces causeries et ces lettres, ce n’était que son trop-plein qui s’écoulait. J’aurais dit que cela le délassait de ses livres, si ses livres l’avaient lassé.
Mais il a écrit comme il parlait, facilement, gaiement, sans fatigue et sans relâche : cela purgeait son esprit, comme eût dit Aristote. Aussi ne peut-on parler ici de labeur artistique, de lente élaboration, de composition savante et réfléchie : toutes ces simagrées ne sont pas sa manière. Ecrire ou parler est une fonction naturelle pour lui ; il n’y fait pas de façon, il se soulage, et il y a de l’impudeur vraiment dans son naturel étalé, dans son improvisation à bride abattue ; tous les endroits lui sont bons, et toutes les occasions. Il s’est attelé à l’Encyclopédie, et comme il veut la mener à bon port, il baisse le ton. Rien ne nous permet mieux de mesurer l’énergie déployée par Diderot dans cette affaire, que ce miracle opéré en lui par le désir de réussir : il a tâché d’être décent, de ne rien lâcher sur le gouvernement ou la religion qui fît par trop scandale. Mais aussi comme la langue lui démangeait pendant qu’il travaillait si sagement ! comme cette besogne l’excitait ! Tout ce qu’il n’avait pas pu dire dans ses articles, il le jetait dans d’autres ouvrages ; ce n’était pas pour la gloire ni pour le gain qu’il écrivait : c’était pour lui, pour évacuer sa pensée. Il publiait ses Pensées sur l’interprétation de la nature, ses drames, son Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***, etc. ; mais son Rêve de d’Alembert, son Supplément au Voyage de Bougainville, son Paradoxe sur le Comédien, sa Religieuse, son Jacques le Fataliste, son Neveu de Rameau, c’est-à-dire le meilleur et le pire, le plus caractéristique en tout cas de son œuvre, tout cela est resté enfoui dans ses papiers. C’était écrit ; il n’en fallait pas plus à Diderot, il avait tiré de son œuvre le plaisir qu’il en attendait. Avec la même indifférence, il semait de ses pages dans les livres de ses amis : un traité de clavecin de Bemetzrieder, une histoire de l’abbé Raynal, une gazette de Grimm, tout lui était bon ; l’essentiel, pour lui, c’était d’écrire ; y mettre son nom n’aurait rien ajouté à son plaisir ! Et, au bout de trente ans de cette effusion sans relâche, je ne garantis pas que Diderot ne soit pas mort avec le regret d’avoir gardé quelque chose d’inexprimé dans son esprit.
Cette intense restitution de pensée était le résultat d’une active absorption ; sa puissante machine toujours sous pression et qui produisait un travail incessant devait être largement alimentée. Diderot n’est point un génie créateur, apte à tirer un monde de soi ; il est loin de Descartes, loin même de Rousseau. Cela l’oblige d’être un savant et un curieux. Emile Faguet l’a très bien dit, il est au courant d’une foule de choses dont la connaissance n’était pas commune en son temps. Quand on s’en tient aux faciles raisonnements de Locke, quand nos gens qui ne s’effraient guère reculent devant Spinoza, non pas devant la hardiesse, mais devant la profondeur de sa doctrine, et craignent de s’y casser la tête, Diderot, sans façon, sans fracas, s’assimile le dur, le grand système de Leibniz : et il n’y pas d’autre raison, je le crois bien, qui lui ait donné en France la réputation d’être une tête allemande. Il a fait des mathématiques, il a fait de la physique, il a fait de l’histoire naturelle, il connaît les plus récentes hypothèses, les expériences les plus suggestives des sciences qui actuellement se constituent et s’étendent. Il connaît la peinture, la musique : je ne dis pas qu’il n’en raisonne un peu à tort et à travers ; mais jamais le défaut de connaissances précises ou techniques n’est la source de ses déviations de jugement. En littérature, il a la plus vaste lecture, il regarder l’étranger, il sait le XVIIe siècle. Il sait aussi beaucoup sur l’antiquité, et ce ne sont pas de vagues impressions d’une lecture rapide ; il voit le détail, il cherche l’exactitude ; s’il lit Horace, il le lit en philologue, en poète, en historien ; s’il lit Pline, il le lit toujours en philologue, mais aussi en peintre, en archéologue, en chimiste ; il prend chaque ouvrage du côté dont un homme de métier le prendrait, avant d’y appuyer ses rêveries personnelles.
Ainsi procède Diderot : sa fécondité n’est pas spontanée. Il a besoin qu’un choc du dehors mette en mouvement les tourbillons de sa pensée, il ne peut donner lui-même la chiquenaude. Il vienne la chiquenaude : voilà tout en branle ; la machine siffle, fume, crache, craque ; on est stupéfait de la disproportion de son action vertigineuse et de son infernal tapage avec le simple geste qui leur a donné naissance. Ainsi Diderot trouve dans Sterne une demi-page qui l’amuse : il part là-dessus, et déroule les trois cents pages de Jacques le Fataliste. Je ne sais s’il a jamais rien fait qui ne soit à l’occasion de quelque chose, et comme une immense réaction de son être contre une impression extérieure. Mais, dira-t-on, n’en est-il pas toujours ainsi ? Non : car d’abord, chez Diderot, le choc n’est pas une émotion quelconque, un fait de son expérience, c’est le choc d’une pensée qui a essayé de se traduire par la parole ou l’art ; puis le détachement de la cause extérieure et de sa pensée interne ne se fait pas ; son œuvre, si vaste qu’elle soit, reste, si je puis dire, épinglée en marge du livre d’autrui ; Diderot est un étourdissant commentateur, plus intéressant souvent que son texte. Il excelle à refaire les livres d’autrui : il est incapable de les juger. Pendant qu’il a l’air d’écouter, il a pris le point de départ où l’a placé l’auteur, et il voyage pour son compte : quand vous avez fini, il vous dit le livre qu’il aurait fait à votre place, et c’est sa façon d’entendre la critique. Dans la conversation, il est le même : de tout ce que vous lui dites en deux heures, il entend une chose, une seule ; il la prend, la travaille, la grandit ; votre toute petite pensée devient un gros système, et qui vous révolte parfois, ou vous épouvante. Voilà le mécanisme mental de Diderot : spontanéité médiocre, réactions prodigieuses.
Posted by : Glyndŵr on samedi 9 mai 2009 | Libellés : Document, Littérature, XVIIIe siècle | 2 Comments
II. Pensée de Diderot (par G. Lanson).
Encyclopédie à part, Diderot n’est guère moins considérable dans le XVIIIe siècle que Voltaire et Rousseau. Avant Rousseau, et quand Voltaire était encore tout ligoté de préjugés, de vanités, d’ambitions mondaines, Diderot s’était franchement déclaré l’homme de la nature. Et voici ce que la nature était pour lui.
Elle était – elle fut du moins de bonne heure – l’athéisme. Dieu n’est pas dans la nature. Il ne saurait y être, et on n’y a que faire de lui. Le monde est un vaste billard où une infinité de billes roulent, se croisent, se choquent, formant un inextricable réseau de mouvements nécessaires, qui ne s’épuisent jamais. Mais la morale ? Elle n’en souffrira pas. « Ne pensez-vous pas qu’on peut être si heureusement né qu’on trouve un grand plaisir à faire le bien ? – Je le pense. – Qu’on peut avoir reçu une excellente éducation, qui fortifie le penchant naturel à la bienfaisance ? – Assurément. – Et que, dans un âge plus avancé, l’expérience nous ait convaincus qu’à tout prendre, il vaut mieux, pour son bonheur dans ce monde, être un honnête homme qu’un coquin ? » Instinct, éducation, expérience : voilà qui suffit pour la morale. Être vertueux pour aller en paradis, c’est prêter à Dieu à la petite semaine ; et le malheur est que les prêteur donne des crocodiles empaillés, non de bonnes espèces ; car la vertu des sacristies, c’est d’aller à la messe, de ne point toucher aux vases sacrés ; l’amour du prochain vient après. La religion, qui punit le sacrilège plus que l’adultère, est immorale ; elle laisse, pour des pratiques, subsister toute la corruption du monde. Elle est source de crimes, fanatisme, guerres, supplices, etc. : c’est acheter trop cher un fondement de la morale, qui ne fonde rien du tout. Dieu existe ou n’existe pas ; s’il existe, il n’existe pas dans la nature ; nous n’avons pas à en tenir compte. Il n’existe pas pour nous ; si nous disons un peu imprudemment qu’il n’existe pas du tout, il n’y a pas grand mal à cela. Qu’un beau jour, hors de la vie, nous nous trouvions face à face avec lui, dans son monde, eh ben, Dieu n’est pas assez mauvais diable pour nous en vouloir de l’avoir nié, quand nous n’avions aucune raison de l’affirmer.
La nature, en second lieu, pour Diderot, c’est le contraire de la société. Tous les maux, tous les vices de l’homme, viennent de la société, qui a inventé la religion, les puissances, les distinctions, la hiérarchie, la richesse, c’est-à-dire l’oppression des uns, la tyrannie des autres, de la corruption et de la misère pour tous, - qui a inventé surtout la morale. Car voilà la caractéristique de Diderot : hardiment, crûment, tantôt cynique et souvent profond, il s’attaque à la morale. Elle n’est qu’une institution sociale, d’autant plus haïssable que sa contrainte hypocrite s’exerce par le dedans : sous le nom de morale, on instruit les enfants à s’interdire quelques plaisirs légitimes qui résultent des fonctions naturelles.
C’est le naturalisme de Rabelais, celui de Panurge et de frère Jean, qui reparaît chez Diderot, dans ces êtres qu’il a choisis et faits conformes à son idéal, dans le Neveu de Rameau et dans Jacques le fataliste. Il supprime toutes les vertus, chrétiennes, stoïciennes, mondaines même, qui n’ont rapport qu’à l’individu, et sont fondées sur le respect de soi-même. Chasteté, pudeur, sobriété, réserve, dignité, sincérité : sottises que tout cela, préjugés et gênes de la société. Le scrupule, la délicatesse sur les moyens sont des grimaces absurdes, quand on est assuré de son intention, et qu’on la sait bonne : voyez le curieux dialogue Est-il bon ? est-il méchant ? un des chefs-d’œuvre de Diderot. Qu’est-ce donc que la vertu ? Elle tient en un mot : c’est la bienfaisance. Tout ce qui est utile à l’humanité est bien ; tout ce qui est nuisible à l’humanité est mal ; ce qui ne fait ni bien ni mal à personne est indifférent ; que je mente, que je me grise, ou pis, qu’importe, si ces actes sont sans effets, sans prolongements funestes au dehors ? Et si, de mon mensonge, ou de mon ivrognerie, il sort un bien pour quelqu’un, j’ai bien fait d’être menteur ou ivrogne. La nature de Diderot l’a sauvé des vices qui avilissent ; pauvre, indépendant, généreux, sans convoitise et sans platitude, il est assez honnête homme pour arriver à faire une sorte de morale avec son instinct. Il s’appuie sur le respect, le culte de la nature, c’est-à-dire des phénomènes, car elle n’en est que la collection. Aussi ne peut-il s’empêcher d’admirer, presque d’aimer ce superbe jaillissement d’énergies naturelles, d’appétits, qu’offre le neveu de Rameau : il tombe d’accord avec lui que « le point important est que vous et moi nous soyons, et que nous soyons vous et moi : que tout aille d’ailleurs comme il pourra ».
La nature, enfin, pour Diderot, c’est la science. Il en a conçu la méthode, les directions, les résultats. Mais ce mot de nature se détermine pour Diderot dans un sens bien moderne. Il n’y aperçoit plus cette nature intérieure que le XVIIe siècle étudiait surtout, dont Descartes croyait l’existence plus assurée et la connaissance plus facile que de la nature extérieure. Toutes ses impulsions, à lui, lui viennent du dehors ; sa philosophie, et celle de son temps, lui dit que toutes ses idées lui sont venues par ses sens : il est naturel que la nature extérieure, et les sciences qui s’y appliquent, soient l’objet de son étude. Dès le milieu du siècle, il annonce, bien témérairement, que le règne des mathématiques est fini : mais il annonce, par une sûre divination, que le règne des sciences naturelles va commencer. Physiologie, physique, c’est de ce coté-là qu’il appelle les jeunes gens, non sans emphase ; mais son geste de charlatan souligne des idées de savant. Avec Diderot le rapport de la philosophie et des sciences semble se renverser : la philosophie renonce à leur imposer ses systèmes, et elle attend leurs découvertes pour en extraire une conception générale de l’univers. La philosophie de Diderot, dans ses parties caractéristiques, est vraiment une philosophie de la nature : ce qu’il tire de Leibniz, ce sont ces principes de raison suffisante, de moindre action, de continuité, que l’étude scientifique du monde organisé et inorganique suppose et vérifie constamment ; et c’est lui d’abord qui, avant Helvétius, avant d’Holbach, remet l’homme dans la nature, et réduit les sciences morales aux sciences naturelles.
Posted by : Glyndŵr on | Libellés : Document, Littérature, XVIIIe siècle | 0 Comments
III. L'art de Diderot (par G. Lanson).
Son art est en harmonie avec son tempérament et avec sa philosophie. Je ne parle pas de l’exécution, souvent lâchée, précipitée, la perfection du travail ne se rencontre guère chez lui. J’entends par son art les intentions d’art qu’il exprime.
Donc, il y aura d’abord chez Diderot un art naturaliste, expressif de la vie telle qu’elle est, des êtres tels qu’on les voit. Sollicité comme il était par la nature extérieure, il la reçoit, et la rend, comme mécaniquement, avec une merveilleuse sûreté. Lisez la Correspondance, et voyez tous ces tableaux, toutes ces anecdotes dont elle est semée. Lisez le Neveu de Rameau, le chef-d’œuvre le plus égal que Diderot ait composé. Cette excentrique et puissante figure s’enlève avec un relief, une netteté incroyables : profil, accent, gestes, grimaces, changements instantanés de ton, de posture, l’identité foncière et toutes les formes mobiles qui la déguisent, tout est noté dans l’étourdissant dialogue de Diderot. Il y a mis beaucoup du sien, sans doute, et il a prêté de ses idées au personnage ; je ne pense pas que le vrai Rameau fut un bohème aussi profond. Mais, avec un instinct étonnant d’art objectif, tout ce qui était sien s’est incorporé à la substance du personnage original dont la vision intérieure guidait sa plume. Dès qu’il conte, il voit ; figures, mouvements, locaux et accessoires, tout est dans son œil, vient sous sa plume ; et son conte est une suite d’estampes.
Mais les estampes ont des légendes, et ces légendes sont romantiques : tout au moins Diderot tend au romantisme. De la nature, il respecte surtout sa nature ; et pourvu qu’il soit, et qu’il soit lui, il ne lui chaut du reste. Le Neveu de Rameau est un heureux accident : ailleurs le subjectif se mêle à l’objectif ; aux impressions de la nature extérieure se superposent, s’enchevêtrent, s’accrochent les élans, les enthousiasmes, les indignations de Denis Diderot, toute une individualité effrénée, bruyante, encombrante. Déjà il porte en lui les germes du lyrisme romantique. En voici la preuve dans deux phrases :
« Le pinson, l’alouette, la linotte, le serin jasent et babillent tant que le jour dure. Le soleil couché, ils fourrent leur tête sous l’aile, et les voilà endormis. C’est alors que le génie prend sa lampe et l’allume, et que l’oiseau solitaire, sauvage, inapprivoisable, brun et triste de plumage, ouvre son gosier, commence son chant, fait retentir le bocage et rompt mélodieusement le silence et les ténèbres de la nuit. » Ne voilà-t-il pas déjà du Chateaubriand ?
« Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d’un rocher qui tombait en poussière ; ils attestèrent de leur constance un ciel qui n’est pas un instant le même ; tout passait en eux, autour d’eux, et ils croyaient leurs cœurs affranchis de vicissitudes. O enfants ! toujours enfants ! » Et ce sont textuellement deux strophes de Musset. Mais le plus curieux, c’est d’aller chercher ce jet de lyrisme où il s’est produit, dans Jacques le Fataliste. Au milieu de la réaliste histoire de Mme de la Pommeraye, tout d’un coup un déchirure se fait dans l’écorce du récit ; une poussée de sentiment jette ces cinq lignes brûlantes, dont nul personnage, ni l’auteur même n’endosse la responsabilité ; aussitôt tout se calme ; et deux minutes après nous buttons sur une énorme polissonnerie. Voilà l’incohérence de Diderot. Il y a de tout dans son style : analyse, synthèse, idée, sensation, hallucination, réalisme, romantisme ; c’est un monde grouillant, qui n’a pas toujours la beauté, qui du moins a souvent la vie.
Cela nous mène à une autre considération : c’est la substitution chez Diderot d’un idéal nouveau à l’idéal classique. Et elle se fait encore, parce qu’il est l’homme de la nature. La nature n’a cure de la beauté, de ce que les hommes conviennent d’appeler ainsi. La nature n’a souci que de la vie : voilà ce qui est beau, naturellement beau. Les formes de la vie et de l’activité de la vie, c’est cela que l’artiste doit s’attacher à rendre : plus ces formes auront de particularité, plus cette activité sera intense, et plus il y aura de beauté dans l’être. Le caractère (et non la régularité, la noblesse, la généralité, éléments classiques de la beauté) doit être l’objet de l’imitation, de l’expression littéraires. C’était l’orientation que déjà Lesage, Marivaux, Prévost avait donnée au roman : mais jamais cette nouvelle esthétique ne s’était aussi puissamment dégagée que dans le Neveu de Rameau.
Posted by : Glyndŵr on | Libellés : Document, Littérature, XVIIIe siècle | 0 Comments
IV. Les "Salons" de Diderot (par G. Lanson).
Il faut dire un mot des fameux Salons de Diderot (1765, 1766, 1767). Cette critique d’art ne nous satisfait plus aujourd’hui. Elle est trop littéraire. Elle saisit trop volontiers le sujet, l’idée, pour en donner un développement qui substitue le travail de l’écrivain au travail du peintre ou du sculpteur. Là, comme ailleurs, la méthode de Diderot consiste à suspendre sa pensée à la pensée d’autrui, en digressions à perde d’haleine ; les tableaux, les statues offrent un débouché de plus au bouillonnement interne de sentimentalité, de réflexion, d’imagination qui fermente en lui.
Cependant, ne soyons pas trop sévères pour Diderot. Aucune vérité, d’abord, n’est vraie de ce diable d’homme, que la vérité contraire ne soit un peu vrai aussi. Avec ce vif sentiment de la réalité que nous avons déjà vu en lui, il voit le tableau, et le fait voir. Avant de déclamer, et tout en déclamant, il nous met sous les yeux la peinture où il accroche ses réflexions ou ses effusions : en cinq lignes, en une demi-page, il nous en donne la sensation. Ce n’est pas un mince talent pour un critique d’art. Il a, de plus, celui de sentir, de signaler le caractère, la justesse expressive des physionomies, des gestes, des attitudes ; ses critiques et ses remarques sont d’un goût original ; on reconnaît l’homme qui voyait naturellement dans leur particularité et dans leurs rapports respectifs les formes extérieures de la vie. Mais il a encore une qualité plus précieuse : c’est de juger, en somme, de la peinture en peintre, de s’intéresser à la lumière, à la couleur, de jouir de leurs combinaisons délicates ou puissantes. Si sa critique n’est pas plus technique, n’est-ce pas que le public ne l’aurait pas suivi ? Et n’est-ce pas aussi que les tableaux, les statues dont il parlait ne le comportaient pas ? Ces œuvres étaient toutes pleines d’intentions littéraires ; elles voulaient agir sur le public par les sujets et par les idées que les sujets suggéraient, idées polissonnes chez Boucher ou Fragonard, idées voluptueuses ou morales chez Greuze, idées philosophiques chez Bouchardon. Les moyens de la peinture et de la statuaire étaient un langage par lequel on s’adressait à l’intelligence. Dans la composition même, c’était encore la littérature qui prévalait : le théâtre fournissait des modèles d’arrangement et un principe de coordination des objets naturels. Diderot eut le tort, sans doute, de pousser dans ce sens. S’il malmena Boucher, il applaudissait à Greuze, il lui criait : « Fais-nous de la morale, mon ami ! » Et Greuze peignait en effet des drames édifiants et ennuyeux comme le Père de famille.
Il reste que les Salons de Diderot sont en leur temps une œuvre considérable. On a le droit de dire qu’il a fondé – sinon la critique d’art – du moins le journalisme d’art. C’est la première fois que nous rencontrons une œuvre littéraire qui compte, et qui ait pour objet les beaux-arts. Diderot fait des tableaux, des statues un objet de littérature, alors qu’antérieurement les arts et la littérature étaient deux mondes fermés, sans communication, et qui n’existaient pas l’un pour l’autre. De même, les artistes et les écrivains vivaient à part, chacun de leur côté : Mme Geoffrin avait son dîner des artistes et son dîner des écrivains, qui n’avaient pas beaucoup de convives communs. Diderot renverse toutes ces barrières. Littérateur, il hante les ateliers, il cause, il dispute ; il frotte ses idées contre leurs théories, son esthétique poétique contre leur esthétique pittoresque ou plastique. Au public enfermé jusqu’ici dans le goût littéraire, il ouvre des fenêtres sur l’art ; à travers toutes ses expansions sentimentales et ses dissertations de penseur, il fait l’éducation des sens de ses lecteurs ; il leur apprend à voir et à jouir, à saisir la vérité d’une attitude, la délicatesse d’un ton. Tout cela se retrouvera plus tard ; et cette communication établie entre l’art et la littérature ne sera pas sans contribuer à la révolution romantique.
Posted by : Glyndŵr on | Libellés : Document, Littérature, XVIIIe siècle | 0 Comments
Les maux d'autrui.
Posted by : Glyndŵr on lundi 4 mai 2009 | Libellés : Littérature, Méditations, Philosophie, Texte du mois. | 1 Comments
Le bonheur dans le crime selon France 2.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu Les diaboliques. Derrière ce titre plutôt accrocheur, un recueil de nouvelles signé Barbey d'Aurevilly. L'annonce relativement accrocheuse de France 2, qui proposait une adaptation du Bonheur dans le crime, a donc naturellement attisé ma curiosité et je me suis, il y a une semaine, tranquillement assise devant mon téléviseur pour voir ce qu'il en était.
Rappelons rapidement l'intrigue générale de cette petite histoire. Un médecin arrive dans une petite ville moribonde, bastion d'aristocrates à l'avenir incertain. Seule activité de la ville : une salle d'armes où officie un bien étrange professeur. Hauteclaire (et non Claire) Stassin, jeune femme ravissante et impassible, donne des cours d'escrime avant de disparaître mystérieusement. On apprend finalement qu'éprise de Savigny, elle a été engagée dans son foyer comme servante, sous le nez de sa femme. Le couple s'arrange pour assassiner la comtesse avant de vivre un bonheur parfait, en dépit de leur crime ...

Présenté comme sulfureux et provocateur, ce téléfilm semble paradoxalement bien moins scandaleux que l'original, confortant le public dans ses opinions, faisant d'une nouvelle "Diabolique" un fait divers lointain, destiné à amuser le public. Parmi les éléments qui m'ont empêchée d'apprécier ce film, pourtant élégamment réalisé, voici :
- Toute l'atmosphère de la nouvelle se base sur l'impassibilité d'Hauteclaire. Maître d'arme, la jeune femme dissimule constamment son visage, que ce soit derrière un masque d'escrime ou un voile. Impossibilité pour le lecteur d('apercevoir son visage, encore moins ses expressions. Le film quant à lui présentera une jeune femme étonnamment proche des hommes, enseignant l'escrime à visage découvert. Et elle sera tout sauf impassible puisqu'elle régale le spectateur d'un petit sourire en coin à chaque seconde. Dimension pourtant très importante dans les nouvelles, élément sur lequel Barbey insiste plus que lourdement, l'impassibilité, le caractère inaccessible du personnage sont complètement eclipsés. Hauteclaire était un sphinx et une diabolique. Quant à la relation entre la jeune femme et Savigny, le choix du scénariste me semble problématique. Là où il y avait une réelle indétermination sexuelle, ("Chose étrange ! dans le rapprochement de ce beau couple, c'était la femme qui avait les muscles, et l'homme qui avait les nerfs !") le film montre un homme passif, se laissant guider par une femme dangereuse et nuisible. Il est assez curieux de voir que, partant d'une nouvelle (et d'un recueil) d'où la condamnation morale est absente, montrant un couple diabolique, l'on prenne bien soin de nous montrer qui il s'agit de condamner et qui semble le plus monstrueux.
Au final, l'adaptation du Bonheur dans le crime semble bien sage. Il s'agit de conforter le public dans ses attentes : on fait ainsi un film élégant en costumes, l'on exacerbe le personnage du médecin, libre-penseur et confiant en les avancées scientifiques. Au contraire, l'on gommera tout élément susceptible de gêner, quand bien même serait-il très présent dans la nouvelle d'origine : sadisme, assassinat prémédité et réalisé sur le long terme, indétermination sexuelle, absence de morale. Barbey rendu classique, Barbey adapté au bon goût bourgeois. En ce sens, Hauteclaire était un sphinx, une diabolique. Claire n'est plus qu'une femme fatale. Dommage.
Image : Félicien Rops -Le bonheur dans le crime
Posted by : Aphonsine on mardi 24 mars 2009 | Libellés : Coup de gueule, Littérature, Télévision | 0 Comments
Des photographies dans un roman ?! Débat autour de Bruges-la-Morte.
Rodenbach use avec Bruges-la-Morte (1892) d'un procédé peu commun et qui en gênera beaucoup. La question se pose, en effet : peut-on légitimement illustrer une œuvre littéraire avec des photographies ? Ne serait-ce pas menacer la création, brider l'imagination du lecteur ? Beaucoup, à l'époque, le penseront.
Précisons d'abord que le problème concerne uniquement l'illustration photographique, le dessin ayant depuis longtemps droit de cité dans les ouvrages de littérature. Mais un procédé nouveau amène de nouvelles questions. S'opère alors une distinction entre l'illustration traditionnelle, qui relève de l'art, et l'illustration photographique, conçue comme pure reproduction du réel. On peut attribuer la distinction à Baudelaire qui, dans un article polémique rédigé à l'occasion du Salon de 1859 (Le public moderne et la photographie), oppose les champs respectifs que doivent occuper photographie et création picturale. Ainsi écrit-il, entre deux invectives :
"S’il est permis à la photographie de suppléer l’art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l’aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait, grâce à l’alliance naturelle qu’elle trouvera dans la sottise de la multitude. Il faut donc qu’elle rentre dans son véritable devoir, qui est d’être la servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l’imprimerie et la sténographie, qui n’ont ni créé ni suppléé la littérature. Qu’elle enrichisse rapidement l’album du voyageur et rende à ses yeux la précision qui manquerait à sa mémoire, qu’elle orne la bibliothèque du naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même de quelques renseignements les hypothèses de l’astronome ; qu’elle soit enfin le secrétaire et le garde-note de quiconque a besoin dans sa profession d’une absolue exactitude matérielle, jusque-là rien de mieux. [...] Mais s’il lui est permis d’empiéter sur le domaine de l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l’homme y ajoute de son âme, alors malheur à nous ! " (je souligne)
Il s'agit bien pour lui de faire la distinction entre "l'art" et "l'industrie". Selon Baudelaire, la photographie ne vaut pas l'art car elle ne vise que la stricte reproduction du réel, et si elle devient autant appréciée, c'est en raison d'un pervertissement du goût. Aucun progrès dans le domaine artistique ne devrait donc relever de cette technique nouvelle et en perpétuelle amélioration. Cette opinion, assénée en 1859, n'a cessé de trouver des échos dans la fin du XIXème siècle, et continuera à cheminer parmi les adversaires de la photographie.

- Mais alors ... Quels rapports entre livre et photographie ?
En revanche, dès qu'il s'agit d'œuvre littéraire, les protestations montent. Citons trois opposants marqués à l'ajout de photographies pour agrémenter un texte littéraire. Il y a Ralph Derechef, critique anglais. Selon lui, "A l'appel du roman illustré par la photographie, seul le mauvais écrivain répondra." Il y a encore Zola qui "ne croit guère au bon emploi ni au bon résultat de ce procédé. On tombera tout de suite dans le nu." Dans la même veine, Octave Uzanne écrit : "L'illustration aura à lutter contre son ennemi masquée, la photographie, et l'imagerie directe et sur nature, à l'aide de procédés chimiques. On tentera un gros effort pour acclimater dans le livre moderne l'exacte fixation des êtres et des choses, mais sans succès, espérons-le."
Les réponses favorables sont plus intéressantes : très peu d'entre elles affichent une pleine confiance en l'art photographique et presque toutes émettent de nombreuses nuances et objections. La photographie dans un roman ? Pourquoi pas, mais quels modèles choisir, comment donner un air de réalité à des scènes posées, si l'on entend représenter des personnages ? Pourquoi pas, mais seulement dans le cas de récits de voyage ou d'écrits réalistes. Pourquoi pas, mais quels problèmes techniques cela va poser ! De multiples questions sont soulevées, sans qu'on puisse apporter de réponse satisfaisante. Au final, bien que de nombreux auteurs se déclarent favorables à l'irruption de photographies dans le texte, la plupart jugeant le procédé selon divers critères (pertinence de l'illustration, type d'ouvrage, public visé). Mentionnons également les auteurs réfractaires à tout type d'illustration ... Je ne peux à ce titre manquer de citer le célèbre Mallarmé : "Je suis pour - aucune illustration, tout ce qu'évoque un livre devant se passer dans l'esprit du lecteur : mais, si vous remplacez la photographie, que n'allez-vous droit au cinématographe, dont le déroulement remplacera, images et textes, maint volume, avantageusement." En vous laissant méditer sur les places respectives que l'on accorde au cinéma et à la littérature de nos jours.

- Bruges-la-Morte et ses silences.
Difficile à appréhender, mêlant texte poétique et photographies réalistes, l'œuvre de Rodenbach sera plusieurs fois amputée de son jeu de photographies. Jusque dans des éditions modernes, on n'hésitera ni à retirer du texte ses images, ni à amputer voire supprimer l'Avertissement qui insiste sur leur importance. L'un des intérêts de l'œuvre est pourtant d'avoir inauguré le genre du récit-photo, où texte et hors-texte tissent de nouveaux réseaux de sens et enrichissent l'interprétation. Les allusions, critiques négatives et même les silences à propos de cette spécificité de l'oeuvre témoignent d'un malaise devant ce nouveau médium qu'est la photographie, qui prendra pourtant une place grandissante dans notre quotidien.
Et à vos yeux, la photographie (et à sa suite de nouveaux médiums) représente-t-elle toujours une menace pour l'art ?
Edition de Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski, GF.)
Notes :
1.En janvier 1898, le Mercure de France mène une enquête, appelant différents artistes à se prononcer sur l'illustration photographique pour les romans.
2. Rappel de l'Avertissement : "Il importe, puisque ces décors de Bruges collaborent aux péripéties, de les reproduire également ici [...] afin que ceux qui nous liront subissent aussi le présence et l'influence de la Ville, éprouvent la contagion des eaux mieux voisines, sentent à leur tour l'ombre des hautes tours allongée sur le texte."
Posted by : Aphonsine on lundi 2 mars 2009 | Libellés : Art, Littérature, Roman, XIXème siècle. | 0 Comments
Voltaire : Micromégas, histoire philosophique. II
..

Récit bref, Micromégas est construit autour d'une répétition de la séquence voyage/conversation. Cependant, d'une séquence à l'autre, la perspective évolue : Micromégas et le saturnien ne constituent pas une énigme l'un pour l'autre, c'est nous, lecteurs, qui sommes surpris de leurs extravagantes propriétés ; lors de la seconde rencontre, en revanche, les Hommes constituent bien un mystère pour les voyageurs ; Voltaire met alors en scène notre propre étrangeté et nous invite à philosopher sur notre condition.
Le conte mélange deux genres en vogue à l'époque : le récit de voyage imaginaire, à la manière des Voyages de Gulliver de Swift(3), avec lequel la filiation semble évidente (voyageurs explorant des mondes inconnus) ; mais aussi le voyage d'un étranger parmi nous, à la manière des Lettres Persanes de Montesquieu (regards étrangers faisant éclater nos absurdités et incohérences). S'il s'en inspire, c'est en partie pour les parodier, le plus souvent au moyen de réécritures : Micromégas est banni pour les mêmes raisons que le héros de Montesquieu, voyage dans les étoiles en utilisant des procédés proches de ceux du Dyrcona de Cyrano, le langage du saturnien caricature le style précieux de Fontenelle , etc. Réécriture, mais aussi inversion des conventions : alors que traditionnellement les voyageurs découvrent un monde utopique qui s'impose à eux, ici, ce sont les voyageurs qui s'imposent à un monde présenté comme « ridicule », « irrégulier », « mal construit »...
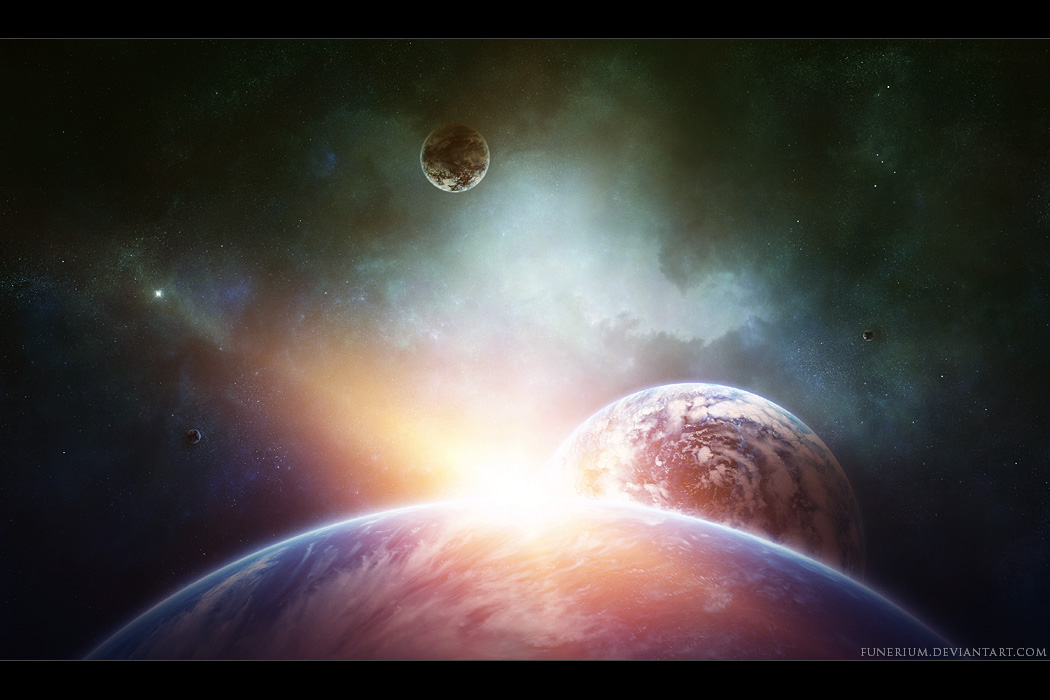
Outre sa dimension parodique, Micromégas dresse également un « état des connaissances et des lectures de Voltaire »(4).
Connaissances scientifiques d'abord : les années 1730, pour Voltaire, sont celles des lectures scientifiques, de l'enthousiasme pour les théories de Newton et des essais d'expérimentations. Tout cela est mis à contribution : Micromégas est présenté comme expérimentateur, observateur, physicien, etc. ; sa rigueur le pousse à contester les conclusions hâtives et péremptoires de son compagnon saturnien, à inventer de nouveaux instruments d'observation et de communication ; ses questionnements mettent en évidence son désir d'approfondir science et philosophie (inséparables dans la quête de sagesse voltairienne). De plus, c'est par le savoir scientifique que voyageurs et humains parviennent à nouer une conversation jugée « intéressante » : « La science apparaît à la fois comme un langage universel et comme le signe le plus évident de la grandeur de l'esprit humain »(5).
Réflexions philosophiques ensuite : la curiosité de Micromégas permet la mise en évidence de caractéristiques essentielles de l'humain : faculté de penser, possibilité d'atteindre un certain niveau de connaissance dans les sciences exactes, mais aussi influences des passions aveugles, qui, mal apprivoisées, peuvent induire fanatisme, intolérance, quête de puissance au détriment des autres, … Dans le domaine des connaissances, bilan mitigé également : le livre blanc de Micromégas marque l'impossibilité de voir « le bout des choses ». Grandeur relative de l'humain, des connaissances : cette leçon de relativisme vaut pour tout le livre : relative grandeur des mers et montagnes, qui, quand on passe à un autre ordre de grandeur ne sont plus qu'étangs et grains de sable ; elle vaut invitation à la modération, mise en évidence de l'absurdité d'un sentiment de supériorité dont, pourtant, on ne se déprend pas si aisément. Ce jeu vertigineux avec les proportions, ce constat des limites humaines pourrait être mis au service d'un sentiment d'angoisse face au mystérieux, à l'infini, comme c'est le cas chez Pascal : Voltaire refuse cette perspective, et, avant Nietzsche, mais après Rabelais, lui oppose le savoir ludique et le rire salvateur. L'Homme est limité ? Qu'il le reconnaisse, l'accepte et en rie : Voltaire n'est peut-être pas un grand philosophe, sa sagesse n'est pas sans faille, mais cette proposition en constitue sans doute l'article le plus intéressant... à mes yeux du moins.
- Cf. la correspondance Voltaire - Frédéric II de juin 1739.
- Jean Goulemot, préface à l'édition Livre de Poche – Libretti de Micromégas, p.11.
- Voir mon article sur Swift : Ici
- Jean Goulemot, op.cit. p.18.
- Idem, p. 20-21.
Posted by : Glyndŵr on | Libellés : Compte-rendu, Conte philosophique, Littérature, Voltaire, XVIIIe siècle | 0 Comments
Voltaire : Micromégas, histoire philosophique. I
.
I - Résumé détaillé.
Chapitre I. On apprend de ce personnage qu'il est originaire de la lointaine étoile Sirius, laquelle a « vingt et un millions six cent mille fois plus de circonférence que notre petite terre », qu'il a fait un voyage sur cette dernière, qu'il est jeune, mesure « huit lieues de haut » (soit environ 32.000 mètres) et qu'il manifeste « beaucoup d'esprit ». C'est d'ailleurs cet esprit qui le fera bannir de la cour pour « huit cent années » par le chef religieux de son pays (le « muphti »), qui a vu de l'hérésie dans un ouvrage de Micromégas où ce dernier traitait de la « forme substantielle » des « puces de Sirius » et des « colimaçons » : passage caractéristique de l'ironie anticléricale de Voltaire, qui en profite, au passage, pour égratigner Blaise Pascal. Nullement affecté par cet ostracisme, Micromégas décide de se lancer dans les voyages interstellaires « pour achever de se former l'esprit et le cœur ». Grâce à son immense taille et à ses grandes connaissances en physique, mettant à profit comètes et énergie solaire (déjà !), il se déplace en sautant de planète en planète « comme un oiseau voltige de branche en branche ». Au terme de ses errances, il arrive sur Saturne, s'étonne de la petitesse des habitants de cette planète qui « n'est guère que neuf cent fois plus [grosse] que la terre », comprend qu'en terme d'esprit ils peuvent « n'être pas ridicule[s] », et se lie d'amitié avec le secrétaire de l'Académie de Sature, caricature du savant et philosophe Fontenelle.
Chapitre II. Le narrateur relate une conversation où les deux personnages se questionnent et s'instruisent mutuellement des connaissances et capacités de leur espèce. Voltaire, ici encore, use pleinement du mécanisme de l'exagération : ainsi, le lecteur apprend que les saturniens possèdent 72 sens, vivent quinze mille ans, connaissent trois cents propriétés de la matière, une trentaine de substances et que la lumière de leur Soleil contient sept couleurs ; mais tout cela n'est rien en comparaison des habitants de Sirius, lesquels possèdent mille sens, vivent « sept cents fois plus longtemps », etc., et Micromégas affirme avoir rencontré « des êtres beaucoup plus parfaits » que lui lors de ces voyages. L'enjeu de cette conversation est double : implicitement, Voltaire raille l'anthropocentrisme et invite l'homme à plus de modestie ; dans le même temps, il questionne l'univers et la nature des êtres pensants : malgré leur plus ou moins de sens et de connaissance, les êtres rencontrés par Micromégas ont au moins une chose en commun : tous se plaignent des limites de leur capacité, de la brièveté de leur existence, « nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce soit une loi universelle de la nature », remarque Micromégas ; Voltaire profite également de la conversation pour faire une profession de foi Déiste, puisqu'il est fait mention du « Créateur » et de l'intelligence de « ses vues », comme en témoigne la perfection de la Nature : « J'admire en tout sa sagesse ; je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi ; vous avez peu de sensations ; votre matière a peu de propriétés : tout cela est l'ouvrage de la providence » affirme le sage géant à son compagnon saturnien. Suite à ce dialogue, les deux amis décident d'entreprendre ensemble un « petit voyage philosophique ».
Chapitre III. Le narrateur raconte leur voyage de Saturne à la Terre. Le moment du départ donne lieu à une brève parodie de dispute amoureuse, dans le genre du roman galant, entre le saturnien et son amante, outrée d'apprendre qu'il la quitte « pour aller voyager avec un géant d'un autre monde » mais qui, nous informe le narrateur, se consola rapidement « avec un petit maître du pays ». Évidemment. La querelle et les larmes passées, les voyageurs se mettent en route, s'arrêtent un an sur Jupiter, en tirent un ouvrage « qui serait actuellement sous presse sans messieurs les inquisiteurs », passent un instant sur Mars, puis rejoignent la Terre par une aurore boréale le 5 Juillet 1737. Le narrateur, critique de l'anthropocentrisme oblige, ne manque pas de noter que la Terre « fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter ».
Chapitre IV. Les deux compagnons effectuent rapidement le tour de la Terre (en 36 heures), le plus grand Océan ne représentant pour eux qu'« un petit étang ». Ils n'aperçoivent d'abord aucune forme de vie ; le saturnien en déduit que la planète n'est pas peuplée ; le géant critique son manque de rigueur : « vous ne voyez pas avec vos petits yeux des étoiles […] que j'aperçois très distinctement ; concluez-vous de là que ces étoiles n'existent pas ? ». Cette remarque permet à Voltaire une critique du témoignage des sens comme critère de vérité, elle marque aussi le point de départ d'une querelle entre les deux compagnons. Querelle pratique puisqu'elle offre une occasion supplémentaire de dévaloriser notre planète : « ce globe-ci est si mal construit, cela est si irrégulier et d'une forme qui me paraît si ridicule ! » dixit le saturnien ; mais surtout fournit l'événement nécessaire à la suite de l'histoire : dans un mouvement de colère, Micromégas perd plusieurs gros diamants, et, en les ramassant, son camarade saturnien s'aperçoit qu'ils constituent de très bons microscopes pour scruter la surface du globe. Ces outils permettent aux aventuriers de repérer « quelque chose d'imperceptible qui remuait entre deux eaux » ; il s'agit d'une baleine. Cela les encourage à poursuivre leur enquête ; ils repèrent « quelque chose de plus gros » : un navire, celui de l'expédition dirigée par le physicien et philosophe Pierre Louis Maupertuis, qui, en 1736-1737, s'était rendu au Pôle Nord pour y vérifier la validité de certaines hypothèses newtoniennes sur la forme du globe. Le narrateur clos le chapitre en affirmant : « Je vais raconter ingénument comme la chose se passa, sans rien y mettre du mien, ce qui n'est pas un petit effort pour un historien. », remarque qui fait sourire quand on sait combien le Siècle de Louis le Grand, ouvrage historique de Voltaire sur le XVIIe siècle, procède du panégyrique.

Chapitre V. Micromégas manipule délicatement le navire, qu'il prend pour un animal : à bord, les hommes paniquent, puis quittent le bâtiment. Les deux géants ne peuvent pas les voir à cause de leur petite taille, d'où une digression voltairienne sur la petitesse de l'homme et sur la relativité de ses actions : bien que cela puisse avoir une grande importance pour certains, que penserait un être comme Micromégas « de ces batailles qui nous ont valu deux villages qu'il a fallu rendre » ? Au passage, sans sortir de son sujet, Voltaire ironise sur Frédéric II : « Je ne doute pas que si quelque capitaine des grands grenadiers lit jamais cet ouvrage, il ne hausse de deux grands pieds au moins les bonnets de sa troupe ; mais je l'avertis qu'il aura beau faire, et que lui et les siens ne seront jamais que des infiniment petits ». Les navigateurs enfoncent finalement un « bâton ferré » dans l'index de Micromégas : cela le chatouille et lui permet de découvrir l'existence des hommes. Cette découverte est source de grande joie pour les deux compagnons, et le chapitre se termine par une nouvelle pique d'ironie du narrateur contre le saturnien-Fontenelle, qui, toujours trop prompt à juger, passe « d'un excès de défiance à un excès de crédulité ».
Chapitre VI. Les voyageurs observent les hommes : comme ils ne peuvent pas les entendre parler, le saturnien déduit, trop hâtivement une fois encore, que les hommes ne possèdent pas l'usage de la parole ; Micromégas lui soutient le contraire ; le Saturnien comprend enfin la leçon : « Je n'ose plus ni croire ni nier […] ; je n'ai plus d'opinion. Il faut tâcher d'examiner ces insectes, nous raisonnerons après ». Micromégas fabrique un appareil pour écouter les hommes : ils parlent ! Très rapidement, les deux voyageurs acquièrent la compréhension puis la maitrise du français. Ils sont fascinés que « des mites [parlent] d'assez bon sens » : ils souhaitent entrer en contact. Micromégas fabrique un autre outil pour atténuer sa voix, car il craint « que sa voix de tonnerre […] n'assourdît les mites sans en être entendue », puis s'adresse aux hommes, étonnés et incapables de « deviner d'où [ces paroles] partaient ». Le nain (le Saturnien, appelé ainsi à cause de la différence de taille entre lui et son compagnon) leur explique qui ils sont et d'où ils viennent, puis leur pose pèle-mêle toute sorte de questions sur leur condition, leur âme, les baleines... L'un des hommes, physicien et géomètre, parvient à mesurer le nain... puis Micromégas, ce qui émerveille ces derniers. Voltaire en profite pour glisser, dans la bouche du géant, une tirade qui sent son Déisme : « Ô Dieu, qui avez donné une intelligence à des substances qui paraissent si méprisables, l'infiniment petit vous coûte aussi peu que l'infiniment grand ».
Chapitre VII. Micromégas croit les hommes parfaitement heureux puisqu'ils manifestent beaucoup d'esprit et sont constitués de peu de matière. Les philosophes démentent, l'un d'eux prend la parole et argumente en évoquant les guerres et massacres perpétrés par les hommes depuis des temps immémoriaux jusqu'au moment présent ; Micromégas lui en demande la cause ; « Il ne s'agit que de savoir si [quelque tas de boue grands comme votre talon] appartiendra à un certain homme qu'on nomme Sultan ou à un autre qu'on nomme […] César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit, et presque aucun de ces animaux qui s'égorgent mutuellement n'a jamais vu l'animal pour lequel ils s'égorgent. » Micromégas désabusé et indigné, le philosophe persiste et signe sur « ces barbares sédentaires qui [...] ordonnent [...] le massacre d'un million d'hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement. ». Le voyageur interstellaire s'intéresse alors plus spécifiquement aux philosophes, qui semblent être « du petit nombre des sages » : il leur pose des questions d'astronomie et de physique ; lui et le nain s'étonnent de la pertinence de leurs réponses ; il les questionne sur des points de métaphysique ; « les philosophes parlèrent tous à la fois […] mais furent de différents avis » : et Voltaire d'ironiser sur les aristotéliciens, cartésiens, malebranchistes et leibnitziens, résumant leurs doctrines complexes en formules incohérentes et grotesques ; vient ensuite le partisan de Locke, penseur dont Voltaire apprécie les idées : son représentant affirme savoir qu'il n'a « jamais pensé qu'à l'occasion de [ses] cinq sens », que la pensée peut être un attribut de la matière, et conclut qu'il « n'affirme rien » mais « [se] contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense » ; évidemment, c'est celui-là qui paraît le plus sage aux géants. À ce moment-là, un théologien s'empare de la parole, prétend détenir la vérité, affirme que tout l'Univers a été créé par Dieu pour l'Homme et, pour prouver tout cela, invoque l'autorité de la Somme de Thomas d'Aquin. Éclats de rire des géants. Ils se reprennent, et Micromégas, bien que « fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand », promet aux hommes un livre de philosophie « écrit fort menu » dans lequel « ils verraient le bout des choses ». Il leur donne le livre puis part. En l'ouvrant, on « ne vit rien qu'un livre tout blanc », signe de l'impossibilité de toute connaissance absolue : « Ah ! Je m'en étais bien douté. », s'écrie le secrétaire de l'Académie des sciences.
Posted by : Glyndŵr on | Libellés : Compte-rendu, Conte philosophique, Littérature, Voltaire, XVIIIe siècle | 3 Comments